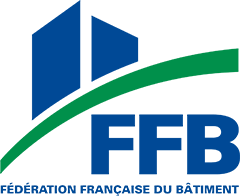Pourquoi transformer les tribunaux de commerce en tribunaux des activités économiques ?
À titre expérimental, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, douze tribunaux de commerce sont renommés tribunaux des activités économiques (TAE) : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.
Ces douze TAE absorbent certaines compétences des tribunaux judiciaires et deviennent seuls compétents pour traiter des procédures amiables et collectives (procédures d’alerte, mandats ad hoc, règlements amiables, conciliations, procédures collectives, par exemple) de tous les professionnels, quels que soient leur statut et leur activité 2.
Le tribunal des activités économiques se compose de juges consulaires du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d’exploitant agricole et de greffiers du tribunal de commerce. Le droit applicable n’est pas modifié.
L’objectif de cette expérimentation est de mesurer l’intérêt d’avoir un seul tribunal pour traiter l’ensemble des procédures amiables et collectives des acteurs économiques.
Un comité composé d’experts et de parlementaires est chargé de remettre un rapport d’évaluation au Parlement avant le 1er juillet 2028.
Une contribution financière3 pour qui et pour quelles demandes ?
La contribution pour la justice économique est due par l’auteur d’une demande initiale4 devant le TAE, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 €.
Les demandes incidentes5 ne sont pas comprises.
Les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions à inclure dans les 50 000 €.
Elle n’est pas due lorsque la demande est formée par le ministère public, l’État, une collectivité territoriale, une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.
De même, toutes les demandes ne donnent pas lieu au paiement de la contribution. Il en va ainsi pour la demande :
- qui a pour objet l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ou qui est formée à l’occasion d’une telle procédure ;
- qui est relative à l’homologation d’un accord issu d’un mode amiable de résolution des différends ou d’une transaction ;
- qui a donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l’effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;
- qui porte sur la contestation de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d’une instance.
Quel est le montant de la contribution ?
Un distinguo est opéré selon que le demandeur est une personne morale ou une personne physique.
Pour les personnes morales ayant un chiffre d’affaires supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 millions d’euros, le montant de la contribution est équivalent à 3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €. Le montant de la contribution est de 5 % pour les chiffres d’affaires supérieurs à 1 500 millions d’euros, dans la limite d’un montant maximal de 100 000 €.
Pour les personnes physiques ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €, le montant de la contribution est de 1 % du montant de la valeur totale des prétentions.
Le montant de la contribution est de 2 % pour les personnes physiques ayant un revenu fiscal supérieur à 500 000 € et de 3 % pour celles ayant un revenu fiscal supérieur à 1 million d’euros.
Le versement de la contribution est effectué au guichet du greffe ou sur www.tribunal-digital.fr.
Peut-on être remboursé ?
La contribution est remboursée en cas de décision constatant l’extinction de l’instance par désistement et en cas de transaction conclue à la suite du recours à un mode alternatif de règlement des différends (MARD).